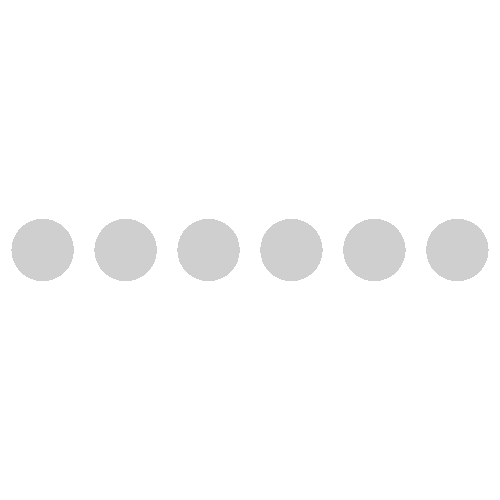Elle n'a-
vait aucun rapport ni avec le syste`me de Berkley, ni avec les
re^veries des sceptiques grecs sur la non-existence de la matie`re,
mais elle maintenait l'e^tre moral dans son inde?
vait aucun rapport ni avec le syste`me de Berkley, ni avec les
re^veries des sceptiques grecs sur la non-existence de la matie`re,
mais elle maintenait l'e^tre moral dans son inde?
Madame de Stael - De l'Allegmagne
le?
ments simples de l'univers, ne sont qu'une
hypothe`se aussi gratuite que toutes celles dont on s'est servi
pour expliquer l'origine des choses; ne? anmoins dans quelle per-
plexite? singulie`re l'esprit humain n'est-il pas? Sans cesse attire?
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 412 ORSERVATIONS GENERALES
vers le secret de son e^tre, il lui est e? galement impossible, et de
le de? couvrir, et de n'y pas songer toujours.
Les Persans disent que Zoroastre interrogea la Divinite? , et
lui demanda comment le monde avait commence? , quand il devait
finir, quelle e? tait l'origine du bien et du mal ? La Divinite? re? pon-
dit a` toutes ces questions -. fais le bien, et gagne l'immortalite? .
Ce qui rend surtout cette re? ponse admirable, c'est qu'elle ne
de? courage point l'homme des me? ditations les plus sublimes;
elle lui enseigne seulement que c'est par la conscience et le sen-
timent qu'il peut s'e? lever aux plus profondes conceptions de la
philosophie.
Leibnitz e? tait un ide? aliste qui ne fondait son syste`me que sur
le raisonnement; et de la` vient qu'il a pousse? trop loin les abs-
tractions, et qu'il n'a point assez appuye? sa the? orie sur la
persuasion intime, seule ve? ritable base de ce qui est supe? rieur a`
l'entendement; en effet, raisonnez sur la liberte? de l'homme,
et vous n'y croirez pas; mettez la main sur votre conscience, et
vous n'en pourrez douter. La conse? quence et la contradiction,
dans le sens que nous attachons a` l'une et a` l'autre, n'existent
pas dans lasphe`redes grandes questionssurlaliberte? de l'homme,
sur l'origine du bien et du mal, sur la prescience divine, etc.
Dans ces questions, le sentiment est presque toujours en op-
position avec le raisonnement, afin que l'homme apprenne que
ce qu'il appelle l'incroyable dans l'ordre des choses terrestres ,
est peut-e^tre la ve? rite? supre^me sous des rapports universels.
Le Dante a exprime? une grande pense? e philosophique par ce
vers:
A guisa del ver primo che l'uom crede '.
Il faut croire a` de certaines ve? rite? s comme a` l'existence; c'est
l'a^me qui nous les re? ve`le, et les raisonnements de tout genre ne
sont jamais que de faibles de? rive? s de cette source.
La The? odice? e de Leibnitz traite de la prescience divine et de la cause du bien et du mal; c'est un des ouvrages les plus pro-
fonds et les mieux raisonne? s sur la the? orie de l'infini; toutefois,
l'auteur applique trop souvent a` ce qui est sans bornes, une lo1 C'est ainsi que l'homme croit a`. la ve? rite? primitive.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? SUIt LA PHILOSOPHIE ALLEMANDE. 413
gique dont les objets circonscrits sont seuls susceptibles. Leibnitz e? tait un homme tre`s-religieux; mais par cela me^me il se
croyait oblige? de fonder les ve? rite? s de la foi sur des raisonne-
ments mathe? matiques, afin de les appuyer sur les bases qui sont
admises dans l'empire de l'expe? rience: cette erreur tient a` un
respect qu'on ne s'avoue pas pour les esprits froids et arides:
on veut les convaincre a` leur manie`re; on croit que des argu-
ments dans la forme logique ont plus de certitude qu'une preuve
de sentiment, et il n'en est rien.
Dans la re? gion des ve? rite? s intellectuelles et religieuses que
Leibnitz a traite? es, il faut se servir de notre conscience intime
comme d'une de? monstration. Leibnitz, en voulant s'en teniraux raisonnements abstraits, exige des esprits une sorte de ten-
sion dont la plupart sont incapables; des ouvrages me? taphysi-
ques qui ne sont fonde? s ni sur l'expe? rience, ni sur le sentiment,
fatiguent singulie`rement la pense? e, et l'on peut en e? prouver un
malaise physique et moral tel, qu'en s'obstinant a` le vaincre on
briserait dans sa te^te les organes de la raison. Un poe`te, Bag-
gesen, fait du Vertige une divinite? ; il faut se recommander a`
elle, quand on veut e? tudier ces ouvrages qui nous placent telle-
ment au sommet des ide? es, que nous n'avons plus d'e? chelons
pour redescendre a` la vie.
Les e? crivains me? taphysiques et religieux, e? loquents et sensibles
tout a` la fois, tels qu'il en existe quelques-uns, conviennent bien
mieux a` notre nature. Loin d'exiger de nous que nos faculte? s
sensibles se taisent, afin que notre faculte? d'abstraction soit plus
nette, ils nous demandent de penser, de sentir, de vouloir, pour
que toute la force de l'a^me nous aide a` pe? ne? trer dans les pro-
fondeurs des cieux; mais s'en tenir a` l'abstraction est un effort
tel, qu'il est assez simple que la plupart des hommes y aient
renonce? , et qu'il leur ait paru plus facile de ne rien admettre
au dela` de ce qui est visible.
La philosophie expe? rimentale est comple`te en elle-me^me : c'est
un tout assez vulgaire, mais compact, borne? , conse? quent; et
quand on s'en tient au raisonnement, tel qu'il est rec? u dans les
affaires de ce monde, on doit s'en contenter; l'immortel et l'in-
fini ne nous sont sensibles que par l'a^me; elle seule peut re? pan-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 414 ORSERVATIONS GE? NE? fULES
dre de l'inte? re^t sur la haute me? taphysique. On se persuade bien
a` tort que plus une the? orie est abstraite, plus elle doit pre? server
de toute illusion ; car c'est pre? cise? ment ainsi qu'elle peut induire
en erreur. On prend l'enchai^nement des ide? es pour leur preuve,
on aligne avec exactitude des chime`res, et l'on se figure que
c'est une arme? e. Il n'y a que le ge? nie du sentiment qui soit au-dessus de la philosophie expe? rimentale, comme de la philosophie
spe? culative; il n'y a que lui qui puisse porter la conviction au
dela` des limites de la raison humaine.
Il me semble donc que, tout en admirant la force de te^te et
la profondeur du ge? nie de Leibnitz, on de? sirerait, dans ses
e? crits sur les questions de the? ologie me? taphysique, plus d'ima-
gination et de sensibilite? , afin de reposer de la pense? e par l'e? -
motion. Leibnitz se faisait presque scrupule d'y recourir, crai-
gnant d'avoir ainsi l'air de se? duire en faveur de la ve? rite? ; il avait
tort, car le sentiment est la ve? rite? elle-me^me, dans des sujets
de cette nature.
Les objections que je me suis permises sur les ouvrages de
Leibnitz qui ont pour objet des questions insolubles par le rai-
sonnement, ne s'appliquent point a` ses e? crits sur la formation
des ide? es dans l'esprit humain; ceux-la` sont d'une clarte? lumi-
neuse, ils portent sur un myste`re que l'homme peut, jusqu'a` un
certain point, pe? ne? trer, car il en sait plus sur lui-me^me que
sur l'univers. Les opinions de Leibnitz a` cet e? gard tendent sur-
tout au perfectionnement moral, s'il est vrai, comme les phi-
losophes allemands ont ta^che? de le prouver, que le libre arbitre
repose sur la doctrine qui affranchit l'a^me des objets exte? rieurs,
et que la vertu ne puisse exister sans la parfaite inde? pendance
du vouloir.
Leibnitz a combattu avec une force dialectique admirable le
syste`me de Locke, qui attribue toutes nos ide? es a` nos sensations.
On avait mis en avant cet axiome si connu, qu'il n'y avait rien
dans l'intelligence qui n'eu^t e? te? d'abord dans les sensations, et
Leibnitz y ajouta cette sublime restriction, si ce n'est l'intelli-
gence elle-me^me '. De ce principe de? rive toute la philosophie
nouvellequi exerce tant d'influence sur les esprits en Allemagne. 'Nihii est in inli'llrcUi, quoil non fuerit in sensu, nisi intcllcctus ipsc.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? SUR l. \ PHILOSOPHIE ALLEMANDE. 415
Cette philosophie est aussi expe? rimentale, car elle s'attache
a` connai^tre ce qui se passe en nous. Elle ne fait que mettre
l'observation du sentiment intime a` la place de celle des sensa-
tions exte? rieures.
La doctrine de Locke eut pour partisans en Allemagne des
hommes qui cherche`rent, comme Bonnet a` Gene`ve, et plusieurs
autres philosophes en Angleterre, a` concilier cette doctrine avec
les sentiments religieux que Locke lui-me^me a toujours profes-
se? s. Le ge? nie de Leibnitz pre? vit toutes les conse? quences de cette
me? taphysique; et ce qui fonde a` jamais sa gloire, c'est d'avoir
su maintenir en Allemagne la philosophie de la liberte? morale
contre celle de la fatalite? sensuelle. Tandis que le reste de l'Eu-
rope adoptait les principes qui font conside? rer l'a^me comme
passive, Leibnitz fut avec constance le de? fenseur e? claire? de la
philosophie ide? aliste, telle que son ge? nie la concevait.
Elle n'a-
vait aucun rapport ni avec le syste`me de Berkley, ni avec les
re^veries des sceptiques grecs sur la non-existence de la matie`re,
mais elle maintenait l'e^tre moral dans son inde? pendance et dans
ses droits.
CHAPITRE VI.
Kant.
Kant a ve? cu jusque dans un a^ge tre`s-avance? , et jamais il n'est
sorti de Koenigsberg; c'est la` qu'au milieu des glaces du Nord,
il a passe? sa vie entie`re a` me? diter sur les lois de l'intelligence hu-
maine. Une ardeur infatigable pour l'e? tude lui a fait acque? rir des
connaissances sans nombre. Les sciences, les langues, la lit-
te? rature, tout lui e? tait familier; et sans rechercher la gloire,
dont il n'a joui que tre`s-tard, n'entendant que dans sa vieillesse
le bruit de sa renomme? e, il s'est contente? du plaisir silencieux de
la re? flexion. Solitaire, il contemplait son a^meavec recueillement;
l'examen de la pense? e lui pre^tait de nouvelles forces a` l'appui de
la vertu, et quoiqu'il ne se me^la^t jamais avec les passions ar-
dentes des hommes, il a su forger des armes pour ceux qui
seraient appele? s a` les combattre.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? ? 410 KANT.
On n'a gue`re d'exemple que chez les Grecs d'une vie aussi
rigoureusement philosophique, et de? ja` cette vie re? pond de la
bonne foi de l'e? crivain. A cette bonne foi la plus pure, il faut
encore ajouter un esprit fin et juste, qui servait de censeur au
ge? nie, quand il se laissait emporter trop loin. C'en est assez,
ce me semble, pour qu'on doive juger au moins impartialement
les travaux perse? ve? rants d'un tel homme.
Kant publia d'abord divers e? crits sur les sciences physiques,
et il montra dans ce genre d'e? tudes une telle sagacite? que c'est
lui qui pre? vit le premier l'existence de la plane`te Uranus. Hers-
chell lui-me^me, apre`s l'avoir de? couverte, a reconnu que c'e? tait
Kant qui l'avait annonce? e. Son traite? sur la nature de l'entende-
ment humain, intitule? Critique de la Raison pure, parut il y a
pre`s de trente ans, et cet ouvrage fut quelque temps inconnu;
mais lorsque enfin on de? couvrit les tre? sors d'ide? es qu'il renferme,
il produisit une telle sensation en Allemagne, que presque tout
ce qui s'est fait depuis, en litte? rature comme en philosophie,
vient de l'impulsion donne? e par cet ouvrage.
A ce traite? sur l'entendement humain succe? da la Critique de
la Raison pratique, qui portait sur la morale, et la Critique
du Jugement, qui avait la nature du beau pour objet; la me^me
the? orie sert de base a` ces trois traite? s, qui embrassent les lois de
l'intelligence, les principes de la vertu et la contemplation des
beaute? s de la nature et des arts.
Je vais ta^cher de donner un aperc? u des ide? es principales que
renferme cette doctrine; quelque soin que je prenne pour l'expo-
ser avec clarte? , je ne me dissimule point qu'il faudra toujours
de l'attention pour la comprendre. Un prince qui apprenait les
mathe? matiques s'impatientait du travail qu'exigeait cette e? tude.
-- Il faut ne? cessairement, lui dit celui qui les enseignait, que
Votre Altesse se donne la peine d'e? tudier pour savoir; car il n'y
a point de route royale en mathe? matiques. -- Le public franc? ais,
qui a tant de raisons de se croire un prince, permettra bien qu'on
lui dise qu'il n'y a point de route royale en me? taphysique, et
que, pour arrivera la conception d'une the? orie quelconque, il
faut passer par les interme? diaires qui ont conduit l'auteur lui-me^me aux re? sultats qu'il pre? sente.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 417
La philosophie mate? rialiste livrait l'entendement humain a` l'empire des objets exte? rieurs, la morale a` l'inte? re^t personnel,
et re? duisait le beau a` n'e^tre que l'agre? able. Kant voulut re? tablir
les ve? rite? s primitives et l'activite? spontane? e dans l'a^me, la cons-
cience dans la morale, et l'ide? al dans les arts. Examinons main-
tenant de quelle manie`re il a atteint ces diffe? rents buts.
A l'e? poque ou` parut la Critique de la Raison pure, il n'exis-
tait que deux syste`mes sur l'entendement humain parmi les
penseurs: l'un, celui de Locke, attribuait toutes nos ide? es a`
nos sensations; l'autre, celui de Descartes et de Leibnitz, s'at-
tachait a` de? montrer la spiritualite? et l'activite? de l'a^me, le libre
arbitre, enfin toute la doctrine ide? aliste; mais ces deux philoso-
phes appuyaient la doctrine sur des preuves purement spe? cu-
latives. J'ai expose? , dans le chapitre pre? ce? dent, les inconve? nients
qui re? sultent de ces efforts d'abstraction, qui arre^tent, pour
ainsi dire , notre sang dans nos veines, afin que les faculte? s in-
tellectuelles re`gnent seules en nous. La me? thode alge? brique
applique? e a` des objets qu'on ne peut saisir par le raisonnement
seul, ne laisse aucune trace durable dans l'esprit. Pendant
qu'on lit ces e? crits sur les hautes conceptions philosophiques,
on croit les comprendre, on croit les croire, mais les arguments
qui ont paru les plus convaincants e? chappent biento^t au souve-
nir.
L'homme, lasse? de ces efforts , se borne-t-il a` ne rien con-
nai^tre que par les sens: tout sera douleur pour son a^me. Aura-
t-il l'ide? e de l'immortalite? , quand les avant-coureurs de la des-
truction sont si profonde? ment grave? s sur le visage des mortels,
et que la nature vivante tombe sans cesse en poussie`re? Lorsque
tous les sens parlent de mourir, quel faible espoir nous entre-
tiendrait de renai^tre? Si l'on ne consultait que les sensations,
quelle ide? e se ferait-on de la bonte? supre^me? Tant de douleurs
se disputent notre vie, tant d'objets hideux de? shonorent la na-
ture, que la cre? ature infortune? e maudit cent fois l'existence,
avant qu'une dernie`re convulsion la lui ravisse. L'homme, au
contraire, rejette-t-il le te? moignage des sens : comment se gui-
dera-t-il sur cette terre? et s'il n'en croyait qu'eux cependant,
quel enthousiasme, quelle morale, quelle religion re? sisteraient
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 418 KANT.
aux assauts re? ite? re? s que leur livreraient tour a` tour la douleur et
le plaisir?
La re? flexion errait dans cette incertitude immense, lorsque
Kant essaya de tracer les limites des deux empires, des sens et
de l'a^me, de la nature exte? rieure et de lanature intellectuelle.
La puissance de me? ditation et la sagesse avec laquelle il marqua
ces limites, n'avaient peut-e^tre point eu d'exemple avant lui; il
ne s'e? gara point dans de nouveaux syste`mes sur la cre? ation de
l'univers; il reconnut les bornes que les myste`res e? ternels im-
posent a` l'esprit humain; et ce qui sera nouveau peut-e^tre pour
ceux qui n'ont fait qu'entendre parler de Kant, c'est qu'il n'y a
point eu de philosophe plus oppose? , sous plusieurs rapports , a`
la me? taphysique; il ne s'est rendu si profond dans cette science
que pour employer les moyens me^mes qu'elle donne a` de? mon-
trer son insuffisance. On dirait que, nouveau Curtius, il s'est jete?
dans le gouffre de l'abstraction pour le combler.
Locke avait combattu victorieusement la doctrine des ide? es
inne? es dans l'homme, parce qu'il a toujours repre? sente? les ide? es
comme faisant partie des connaissances expe? rimentales. L'exa-
men de la raison pure, c'est-a`-dire des faculte? s primitives dont
l'intelligence se compose, ne fixa pas son attention. Leibnitz,
comme nous l'avons dit plus haut, prononc? a cet axiome subli-
me: << Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne par les sens,
si ce n'est l'intelligence elle-me^me. >> Kant a reconnu, de
me^me que Locke, qu'il n'y a point d'ide? es inne? es, mais il s'est
propose? de pe? ne? trer dans le sens de l'axiome de Leibnitz, en
examinant quelles sont les lois et les sentiments qui constituent
l'essence de l'a^me humaine, inde? pendamment de toute expe? -
rience. La Critique de la Raison pure s'attache a` montrer en
quoi consistent ces lois, et quels sont les objets sur lesquels elles
peuvent s'exercer.
Le scepticisme, auquel le mate? rialisme conduit presque tou-
jours, e? tait porte? s! loin, que Hume avait fini par e? branler la base
du raisonnement me^me, en cherchant des arguments contre
l'axiome << qu'il n'y a point d'effet sans cause. >> Ettelle est l'insta-
bilite? de la nature humaine, quand on ne place pas au centre de
l'a^me le principe de toute conviction, que l'incre? dulite? , qui com-
? ?
hypothe`se aussi gratuite que toutes celles dont on s'est servi
pour expliquer l'origine des choses; ne? anmoins dans quelle per-
plexite? singulie`re l'esprit humain n'est-il pas? Sans cesse attire?
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 412 ORSERVATIONS GENERALES
vers le secret de son e^tre, il lui est e? galement impossible, et de
le de? couvrir, et de n'y pas songer toujours.
Les Persans disent que Zoroastre interrogea la Divinite? , et
lui demanda comment le monde avait commence? , quand il devait
finir, quelle e? tait l'origine du bien et du mal ? La Divinite? re? pon-
dit a` toutes ces questions -. fais le bien, et gagne l'immortalite? .
Ce qui rend surtout cette re? ponse admirable, c'est qu'elle ne
de? courage point l'homme des me? ditations les plus sublimes;
elle lui enseigne seulement que c'est par la conscience et le sen-
timent qu'il peut s'e? lever aux plus profondes conceptions de la
philosophie.
Leibnitz e? tait un ide? aliste qui ne fondait son syste`me que sur
le raisonnement; et de la` vient qu'il a pousse? trop loin les abs-
tractions, et qu'il n'a point assez appuye? sa the? orie sur la
persuasion intime, seule ve? ritable base de ce qui est supe? rieur a`
l'entendement; en effet, raisonnez sur la liberte? de l'homme,
et vous n'y croirez pas; mettez la main sur votre conscience, et
vous n'en pourrez douter. La conse? quence et la contradiction,
dans le sens que nous attachons a` l'une et a` l'autre, n'existent
pas dans lasphe`redes grandes questionssurlaliberte? de l'homme,
sur l'origine du bien et du mal, sur la prescience divine, etc.
Dans ces questions, le sentiment est presque toujours en op-
position avec le raisonnement, afin que l'homme apprenne que
ce qu'il appelle l'incroyable dans l'ordre des choses terrestres ,
est peut-e^tre la ve? rite? supre^me sous des rapports universels.
Le Dante a exprime? une grande pense? e philosophique par ce
vers:
A guisa del ver primo che l'uom crede '.
Il faut croire a` de certaines ve? rite? s comme a` l'existence; c'est
l'a^me qui nous les re? ve`le, et les raisonnements de tout genre ne
sont jamais que de faibles de? rive? s de cette source.
La The? odice? e de Leibnitz traite de la prescience divine et de la cause du bien et du mal; c'est un des ouvrages les plus pro-
fonds et les mieux raisonne? s sur la the? orie de l'infini; toutefois,
l'auteur applique trop souvent a` ce qui est sans bornes, une lo1 C'est ainsi que l'homme croit a`. la ve? rite? primitive.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? SUIt LA PHILOSOPHIE ALLEMANDE. 413
gique dont les objets circonscrits sont seuls susceptibles. Leibnitz e? tait un homme tre`s-religieux; mais par cela me^me il se
croyait oblige? de fonder les ve? rite? s de la foi sur des raisonne-
ments mathe? matiques, afin de les appuyer sur les bases qui sont
admises dans l'empire de l'expe? rience: cette erreur tient a` un
respect qu'on ne s'avoue pas pour les esprits froids et arides:
on veut les convaincre a` leur manie`re; on croit que des argu-
ments dans la forme logique ont plus de certitude qu'une preuve
de sentiment, et il n'en est rien.
Dans la re? gion des ve? rite? s intellectuelles et religieuses que
Leibnitz a traite? es, il faut se servir de notre conscience intime
comme d'une de? monstration. Leibnitz, en voulant s'en teniraux raisonnements abstraits, exige des esprits une sorte de ten-
sion dont la plupart sont incapables; des ouvrages me? taphysi-
ques qui ne sont fonde? s ni sur l'expe? rience, ni sur le sentiment,
fatiguent singulie`rement la pense? e, et l'on peut en e? prouver un
malaise physique et moral tel, qu'en s'obstinant a` le vaincre on
briserait dans sa te^te les organes de la raison. Un poe`te, Bag-
gesen, fait du Vertige une divinite? ; il faut se recommander a`
elle, quand on veut e? tudier ces ouvrages qui nous placent telle-
ment au sommet des ide? es, que nous n'avons plus d'e? chelons
pour redescendre a` la vie.
Les e? crivains me? taphysiques et religieux, e? loquents et sensibles
tout a` la fois, tels qu'il en existe quelques-uns, conviennent bien
mieux a` notre nature. Loin d'exiger de nous que nos faculte? s
sensibles se taisent, afin que notre faculte? d'abstraction soit plus
nette, ils nous demandent de penser, de sentir, de vouloir, pour
que toute la force de l'a^me nous aide a` pe? ne? trer dans les pro-
fondeurs des cieux; mais s'en tenir a` l'abstraction est un effort
tel, qu'il est assez simple que la plupart des hommes y aient
renonce? , et qu'il leur ait paru plus facile de ne rien admettre
au dela` de ce qui est visible.
La philosophie expe? rimentale est comple`te en elle-me^me : c'est
un tout assez vulgaire, mais compact, borne? , conse? quent; et
quand on s'en tient au raisonnement, tel qu'il est rec? u dans les
affaires de ce monde, on doit s'en contenter; l'immortel et l'in-
fini ne nous sont sensibles que par l'a^me; elle seule peut re? pan-
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 414 ORSERVATIONS GE? NE? fULES
dre de l'inte? re^t sur la haute me? taphysique. On se persuade bien
a` tort que plus une the? orie est abstraite, plus elle doit pre? server
de toute illusion ; car c'est pre? cise? ment ainsi qu'elle peut induire
en erreur. On prend l'enchai^nement des ide? es pour leur preuve,
on aligne avec exactitude des chime`res, et l'on se figure que
c'est une arme? e. Il n'y a que le ge? nie du sentiment qui soit au-dessus de la philosophie expe? rimentale, comme de la philosophie
spe? culative; il n'y a que lui qui puisse porter la conviction au
dela` des limites de la raison humaine.
Il me semble donc que, tout en admirant la force de te^te et
la profondeur du ge? nie de Leibnitz, on de? sirerait, dans ses
e? crits sur les questions de the? ologie me? taphysique, plus d'ima-
gination et de sensibilite? , afin de reposer de la pense? e par l'e? -
motion. Leibnitz se faisait presque scrupule d'y recourir, crai-
gnant d'avoir ainsi l'air de se? duire en faveur de la ve? rite? ; il avait
tort, car le sentiment est la ve? rite? elle-me^me, dans des sujets
de cette nature.
Les objections que je me suis permises sur les ouvrages de
Leibnitz qui ont pour objet des questions insolubles par le rai-
sonnement, ne s'appliquent point a` ses e? crits sur la formation
des ide? es dans l'esprit humain; ceux-la` sont d'une clarte? lumi-
neuse, ils portent sur un myste`re que l'homme peut, jusqu'a` un
certain point, pe? ne? trer, car il en sait plus sur lui-me^me que
sur l'univers. Les opinions de Leibnitz a` cet e? gard tendent sur-
tout au perfectionnement moral, s'il est vrai, comme les phi-
losophes allemands ont ta^che? de le prouver, que le libre arbitre
repose sur la doctrine qui affranchit l'a^me des objets exte? rieurs,
et que la vertu ne puisse exister sans la parfaite inde? pendance
du vouloir.
Leibnitz a combattu avec une force dialectique admirable le
syste`me de Locke, qui attribue toutes nos ide? es a` nos sensations.
On avait mis en avant cet axiome si connu, qu'il n'y avait rien
dans l'intelligence qui n'eu^t e? te? d'abord dans les sensations, et
Leibnitz y ajouta cette sublime restriction, si ce n'est l'intelli-
gence elle-me^me '. De ce principe de? rive toute la philosophie
nouvellequi exerce tant d'influence sur les esprits en Allemagne. 'Nihii est in inli'llrcUi, quoil non fuerit in sensu, nisi intcllcctus ipsc.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? SUR l. \ PHILOSOPHIE ALLEMANDE. 415
Cette philosophie est aussi expe? rimentale, car elle s'attache
a` connai^tre ce qui se passe en nous. Elle ne fait que mettre
l'observation du sentiment intime a` la place de celle des sensa-
tions exte? rieures.
La doctrine de Locke eut pour partisans en Allemagne des
hommes qui cherche`rent, comme Bonnet a` Gene`ve, et plusieurs
autres philosophes en Angleterre, a` concilier cette doctrine avec
les sentiments religieux que Locke lui-me^me a toujours profes-
se? s. Le ge? nie de Leibnitz pre? vit toutes les conse? quences de cette
me? taphysique; et ce qui fonde a` jamais sa gloire, c'est d'avoir
su maintenir en Allemagne la philosophie de la liberte? morale
contre celle de la fatalite? sensuelle. Tandis que le reste de l'Eu-
rope adoptait les principes qui font conside? rer l'a^me comme
passive, Leibnitz fut avec constance le de? fenseur e? claire? de la
philosophie ide? aliste, telle que son ge? nie la concevait.
Elle n'a-
vait aucun rapport ni avec le syste`me de Berkley, ni avec les
re^veries des sceptiques grecs sur la non-existence de la matie`re,
mais elle maintenait l'e^tre moral dans son inde? pendance et dans
ses droits.
CHAPITRE VI.
Kant.
Kant a ve? cu jusque dans un a^ge tre`s-avance? , et jamais il n'est
sorti de Koenigsberg; c'est la` qu'au milieu des glaces du Nord,
il a passe? sa vie entie`re a` me? diter sur les lois de l'intelligence hu-
maine. Une ardeur infatigable pour l'e? tude lui a fait acque? rir des
connaissances sans nombre. Les sciences, les langues, la lit-
te? rature, tout lui e? tait familier; et sans rechercher la gloire,
dont il n'a joui que tre`s-tard, n'entendant que dans sa vieillesse
le bruit de sa renomme? e, il s'est contente? du plaisir silencieux de
la re? flexion. Solitaire, il contemplait son a^meavec recueillement;
l'examen de la pense? e lui pre^tait de nouvelles forces a` l'appui de
la vertu, et quoiqu'il ne se me^la^t jamais avec les passions ar-
dentes des hommes, il a su forger des armes pour ceux qui
seraient appele? s a` les combattre.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? ? 410 KANT.
On n'a gue`re d'exemple que chez les Grecs d'une vie aussi
rigoureusement philosophique, et de? ja` cette vie re? pond de la
bonne foi de l'e? crivain. A cette bonne foi la plus pure, il faut
encore ajouter un esprit fin et juste, qui servait de censeur au
ge? nie, quand il se laissait emporter trop loin. C'en est assez,
ce me semble, pour qu'on doive juger au moins impartialement
les travaux perse? ve? rants d'un tel homme.
Kant publia d'abord divers e? crits sur les sciences physiques,
et il montra dans ce genre d'e? tudes une telle sagacite? que c'est
lui qui pre? vit le premier l'existence de la plane`te Uranus. Hers-
chell lui-me^me, apre`s l'avoir de? couverte, a reconnu que c'e? tait
Kant qui l'avait annonce? e. Son traite? sur la nature de l'entende-
ment humain, intitule? Critique de la Raison pure, parut il y a
pre`s de trente ans, et cet ouvrage fut quelque temps inconnu;
mais lorsque enfin on de? couvrit les tre? sors d'ide? es qu'il renferme,
il produisit une telle sensation en Allemagne, que presque tout
ce qui s'est fait depuis, en litte? rature comme en philosophie,
vient de l'impulsion donne? e par cet ouvrage.
A ce traite? sur l'entendement humain succe? da la Critique de
la Raison pratique, qui portait sur la morale, et la Critique
du Jugement, qui avait la nature du beau pour objet; la me^me
the? orie sert de base a` ces trois traite? s, qui embrassent les lois de
l'intelligence, les principes de la vertu et la contemplation des
beaute? s de la nature et des arts.
Je vais ta^cher de donner un aperc? u des ide? es principales que
renferme cette doctrine; quelque soin que je prenne pour l'expo-
ser avec clarte? , je ne me dissimule point qu'il faudra toujours
de l'attention pour la comprendre. Un prince qui apprenait les
mathe? matiques s'impatientait du travail qu'exigeait cette e? tude.
-- Il faut ne? cessairement, lui dit celui qui les enseignait, que
Votre Altesse se donne la peine d'e? tudier pour savoir; car il n'y
a point de route royale en mathe? matiques. -- Le public franc? ais,
qui a tant de raisons de se croire un prince, permettra bien qu'on
lui dise qu'il n'y a point de route royale en me? taphysique, et
que, pour arrivera la conception d'une the? orie quelconque, il
faut passer par les interme? diaires qui ont conduit l'auteur lui-me^me aux re? sultats qu'il pre? sente.
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 417
La philosophie mate? rialiste livrait l'entendement humain a` l'empire des objets exte? rieurs, la morale a` l'inte? re^t personnel,
et re? duisait le beau a` n'e^tre que l'agre? able. Kant voulut re? tablir
les ve? rite? s primitives et l'activite? spontane? e dans l'a^me, la cons-
cience dans la morale, et l'ide? al dans les arts. Examinons main-
tenant de quelle manie`re il a atteint ces diffe? rents buts.
A l'e? poque ou` parut la Critique de la Raison pure, il n'exis-
tait que deux syste`mes sur l'entendement humain parmi les
penseurs: l'un, celui de Locke, attribuait toutes nos ide? es a`
nos sensations; l'autre, celui de Descartes et de Leibnitz, s'at-
tachait a` de? montrer la spiritualite? et l'activite? de l'a^me, le libre
arbitre, enfin toute la doctrine ide? aliste; mais ces deux philoso-
phes appuyaient la doctrine sur des preuves purement spe? cu-
latives. J'ai expose? , dans le chapitre pre? ce? dent, les inconve? nients
qui re? sultent de ces efforts d'abstraction, qui arre^tent, pour
ainsi dire , notre sang dans nos veines, afin que les faculte? s in-
tellectuelles re`gnent seules en nous. La me? thode alge? brique
applique? e a` des objets qu'on ne peut saisir par le raisonnement
seul, ne laisse aucune trace durable dans l'esprit. Pendant
qu'on lit ces e? crits sur les hautes conceptions philosophiques,
on croit les comprendre, on croit les croire, mais les arguments
qui ont paru les plus convaincants e? chappent biento^t au souve-
nir.
L'homme, lasse? de ces efforts , se borne-t-il a` ne rien con-
nai^tre que par les sens: tout sera douleur pour son a^me. Aura-
t-il l'ide? e de l'immortalite? , quand les avant-coureurs de la des-
truction sont si profonde? ment grave? s sur le visage des mortels,
et que la nature vivante tombe sans cesse en poussie`re? Lorsque
tous les sens parlent de mourir, quel faible espoir nous entre-
tiendrait de renai^tre? Si l'on ne consultait que les sensations,
quelle ide? e se ferait-on de la bonte? supre^me? Tant de douleurs
se disputent notre vie, tant d'objets hideux de? shonorent la na-
ture, que la cre? ature infortune? e maudit cent fois l'existence,
avant qu'une dernie`re convulsion la lui ravisse. L'homme, au
contraire, rejette-t-il le te? moignage des sens : comment se gui-
dera-t-il sur cette terre? et s'il n'en croyait qu'eux cependant,
quel enthousiasme, quelle morale, quelle religion re? sisteraient
? ? Generated for (University of Chicago) on 2014-12-22 00:49 GMT / http://hdl. handle. net/2027/hvd. hwnks5 Public Domain, Google-digitized / http://www. hathitrust. org/access_use#pd-google
? 418 KANT.
aux assauts re? ite? re? s que leur livreraient tour a` tour la douleur et
le plaisir?
La re? flexion errait dans cette incertitude immense, lorsque
Kant essaya de tracer les limites des deux empires, des sens et
de l'a^me, de la nature exte? rieure et de lanature intellectuelle.
La puissance de me? ditation et la sagesse avec laquelle il marqua
ces limites, n'avaient peut-e^tre point eu d'exemple avant lui; il
ne s'e? gara point dans de nouveaux syste`mes sur la cre? ation de
l'univers; il reconnut les bornes que les myste`res e? ternels im-
posent a` l'esprit humain; et ce qui sera nouveau peut-e^tre pour
ceux qui n'ont fait qu'entendre parler de Kant, c'est qu'il n'y a
point eu de philosophe plus oppose? , sous plusieurs rapports , a`
la me? taphysique; il ne s'est rendu si profond dans cette science
que pour employer les moyens me^mes qu'elle donne a` de? mon-
trer son insuffisance. On dirait que, nouveau Curtius, il s'est jete?
dans le gouffre de l'abstraction pour le combler.
Locke avait combattu victorieusement la doctrine des ide? es
inne? es dans l'homme, parce qu'il a toujours repre? sente? les ide? es
comme faisant partie des connaissances expe? rimentales. L'exa-
men de la raison pure, c'est-a`-dire des faculte? s primitives dont
l'intelligence se compose, ne fixa pas son attention. Leibnitz,
comme nous l'avons dit plus haut, prononc? a cet axiome subli-
me: << Il n'y a rien dans l'intelligence qui ne vienne par les sens,
si ce n'est l'intelligence elle-me^me. >> Kant a reconnu, de
me^me que Locke, qu'il n'y a point d'ide? es inne? es, mais il s'est
propose? de pe? ne? trer dans le sens de l'axiome de Leibnitz, en
examinant quelles sont les lois et les sentiments qui constituent
l'essence de l'a^me humaine, inde? pendamment de toute expe? -
rience. La Critique de la Raison pure s'attache a` montrer en
quoi consistent ces lois, et quels sont les objets sur lesquels elles
peuvent s'exercer.
Le scepticisme, auquel le mate? rialisme conduit presque tou-
jours, e? tait porte? s! loin, que Hume avait fini par e? branler la base
du raisonnement me^me, en cherchant des arguments contre
l'axiome << qu'il n'y a point d'effet sans cause. >> Ettelle est l'insta-
bilite? de la nature humaine, quand on ne place pas au centre de
l'a^me le principe de toute conviction, que l'incre? dulite? , qui com-
? ?